1- Pauvre orthographe!
On se demande par moments
quel charabia manipule Raymond Queneau, il est sûr, en tout cas, qu'il prend beaucoup
de libertés avec la sacro-sainte orthographe. Cette orthographe, Marcel
Pagnol, qui n'était pas un puriste borné, disait, pourtant, lors de son
entrée à l'Académie Française, qu'il voulait la protéger, pour permettre à
ses petits-enfants de comprendre plus tard ce qu'il avait écrit.
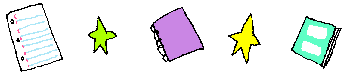
Au contraire, pour
comprendre certaines tournures des Fleurs Bleues, il est parfois utile d'oublier
ce qu'on sait, et de lire tout haut cette écriture phonétique. Voici de la fantaisie
pure:
"Stéphane, ainsi
nommé parce qu'il était peu causant", "Stèfstu esténoci",
"tu feras terstène".
Cidrolin épèle
son nom: " Dicornil (vous avez, bien sûr, observé que Dicornil =
Cidrolin: pour camoufler son nom, le malin a fait un anagramme!). Monsieur
Dicornil. D. comme duc, I. comme Joachim, C. comme Capétien, O. comme
Onésiphore, R. comme Riphinte, N. comme N. et le reste à l'avenant.
- Dupont. C'est bien
cela? Pour monsieur Dupont?
- Vous m'avez
compris"...!!!
Voici des
transcriptions
populaires:
Rendu phonétique de
prononciations
ou locutions familières:
"grammerci, asteure,
je mdemande, les ouatures, les douas, les châtiaux, Lamélie, Lalix, une
gorgée de rome".
Rendu phonétique de mots
étrangers:
"sandouiche, stèques, ouesterne, gueurle, stripeutise, standigne,
vatères, campigne, interviouve..."
Rendu phonétiques de mots
en initiales:
"la éssésse, les
vécés, les céhéresses, la tévé, l'achélème, l'ératépiste..."
Voici des libertés
qui peuvent cacher une intention:
"chevals, chevaus,
genous, chous gras" refusent
l'adjonction assez arbitraire de l'x pour marquer le pluriel, et "sculteur"
supprime une complication artificielle,
"les cors"
(des ennemis morts), qui ne sont pas seulement ceux qu'ils avaient aux pieds,
rappellent aussi les "signes sonores" qui ouvraient les
hostilités,
les "emmendes"
ont une belle concision expressive,
la confusion "sourcier-sorcier"
va de soi,
"la ténèbre
grottesque" joue sur deux
tableaux,
ils"fou-rirent
tous les deux" donne beaucoup de vivacité,
"les anchois sont
des harengs pluvieux"
critiquent un mauvais repas, qui rend mélancolique.
2- A quoi jouent ces
mots-là!
Avec ces approximations,
nous sommes déjà aux jeux de mots, un des éléments essentiels des
Fleurs Bleues, comme nous en avertit le duc dès les premières lignes: "tant
d'histoire pour quelques calembours... quelques anachronismes."
Les moyens et les effets
sont multiples.
Voici le plus vrai, le
plus laborieux calembour du texte:
"Si bèle le zèbre
ut, voilà Belzébut", le
seul, je crois.
En revanche, les fausses
bourdes par approximations abondent. Elles mettent ensemble des choses sans
rapport logique:
-"prendre les mots
à leur valeur faciale" ne
veut rien dire, tout en semblant très net,
-"foi
d'Empoigne" et "chevaus
sur la soupe" mènent deux idées à la fois,
de même, "nenni
soit qui mal y pense... Copernic soit qui mal y pense" (pour -"honni soit...", devise de l'ordre de la Jarretière) lient la pensée
du duc à la conversation,
-"prendre un
chaud-froid de bouillon"
évoque la gastronomie et, avec les vicissitudes de la Croisade, le premier roi
de Jérusalem, Godefroy de Bouillon,
"l'espadrille", ce mot pris pour un autre dans un
échange sur les courses de taureaux ajoute l'estocade aux banderilles, tout en
évoquant la légèreté du matador.
Les approximations
amènent les enchaînements de sons et d'idées les plus baroques et les
plus saugrenus:
"deux Huns, non loin
d'eux, un Gaulois Eduen" (2,
1, 2, 1 et 2, 1)
" Romains
fatigués" (de travailler
comme...),
"Sarrasins de Corinthe" (raisins de Corinthe),
"Francs
anciens" (les nouveaux Francs furent mis en circulation à l'époque
où ce livre paraissait), "Alains seuls" (un linceul),
"les
Huns préparaient des stèques tartares" (dont ils furent grands
consommateurs),
"le Gaulois fumait une gitane" (on attendait
une gauloise),
"les Romains dessinaient des grecques" ( monde
gréco-romain),
"les Sarrasins fauchaient de l'avoine" (deux
céréales),
"les Francs cherchaient des sols" (monnaie pour
monnaie),
"les Alains regardaient cinq Ossètes" (chiffres).
Dans le même esprit,
vous découvrez les astuces de:
"Celtes,
air gallican", "Romains, air césarien", Sarrasins, air
agricole", Huns, air unique", Alains, air narte", Francs, air
sournois".
La répétition,
qui
est "l'une des fleurs les plus odoriférantes de la rhétorique", se
rencontre partout:
Répétitions de sons
qui font assonnance ou rime:
"l'horrifié
hérault terrifié", "sans cadence ils avancent en silence, la corde
se balance", "demoiselle... oiselle iroquoiselle", "Amélie,
hagarde, le regarde".
Répétitions
de mots:
"vous pensez... je pense...
je pense... je pense... vous pensez... je pense...", s'opposant
à "vous avez rêvé, vous
rêvâtes, vous rêviez, vous rêvez",
"deviner": pas
loin de vingt fois en onze lignes, dont voici la fin: "...il
devinait que le duc avait deviné qu'il avait deviné".
Fausses maladresses:
"dit le duc d'Auge
au duc d'Auge", "Cidrolin dit à Cidrolin", qui,
en substituant la répétition au pronom réfléchi, met la personne face à
elle-même, et amorce le dédoublement, sur quoi se fonde l'argument du livre,
"pas tout à fait
inachevé... pas tout à fait achevé"
qui renouvelle l'expression: "ni fait, ni à faire".
Phrases répétées,
avec de menues variantes, soit dans le même passage, soit tout au long du livre
(nous reviendrons sans doute sur certaines de ces rengaines
significatives):
"les Normands
buvaient du calva" ,
"à la tévé, on
baise guère",
"encore un de
foutu",
"vous devriez vous
corriger",
"c'est un nom qui me
dit quelque chose",
"vous buvez trop! -
tout le monde me le dit",
"vous cassez pas la
gueule... attention de pas vous foutre dans la flotte",
corrigé, devant des
visiteurs distingués, en:
"faites
attention de ne pas vous casser la figure... faites attention de ne pas vous
flanquer à l'eau".
"de loin c'est
chouette, mais de près c'est dégueulasse".
"l'eau paraît un
peu sale, mais elle n'est pas stagnante. Ce ne sont pas toujours les mêmes
ordures qu'on voit. Des fois, je les pousse avec un bâton, elles s'en vont au
fil de l'eau. De ce côté-là, tout de même, en effet, ça croupit un
peu."
Une expression,
prise à la lettre, ou dans différentes
acceptions, ou hors du sens habituel,
qui crée l'inattendu!
"son humeur était
de battre. Il ne battit point sa femme parce que défunte, mais il battit ses
filles... il battit des serviteurs, des servantes, des tapis, quelques fers
encore chauds, la campagne, monnaie et, en fin de compte, ses flancs."
"des couples
pratiquaient le bouche à bouche",
"cela faisait
longtemps que vous n'étiez venu? - plus d'un siècle... je veux dire: très
longtemps": le duc n'a pas
vu Paris depuis la Révolution,
"discuter à bâtons
rompus": le duc vient de
casser une escabelle sur le dos de son cuisinier,
"bêtes à bon
dieu": les curés,
"un abbé de choc:
si le duc lui flanquait un coup de pied, il en rendait deux",
"il avait tout pour
déplaire",
"l'Arche: sans doute
parce qu'il n'y loge aucun animal",
"permis
gastronomique",
"torchon
polyvalent",
C.R.S.= "compagnies
royales de sécurité",
"Allons, voyons, messire, dit
Onésiphore (l'abbé) sur un ton de doux reproche, un peu de modération, je ne
vais pas avoir le temps de lui donner les derniers sacrements", le
duc est en train d'étrangler un malheureux astrologue.
Aller
à la page suivante: 4) Plein d'astuces plus ou moins vaseuses

